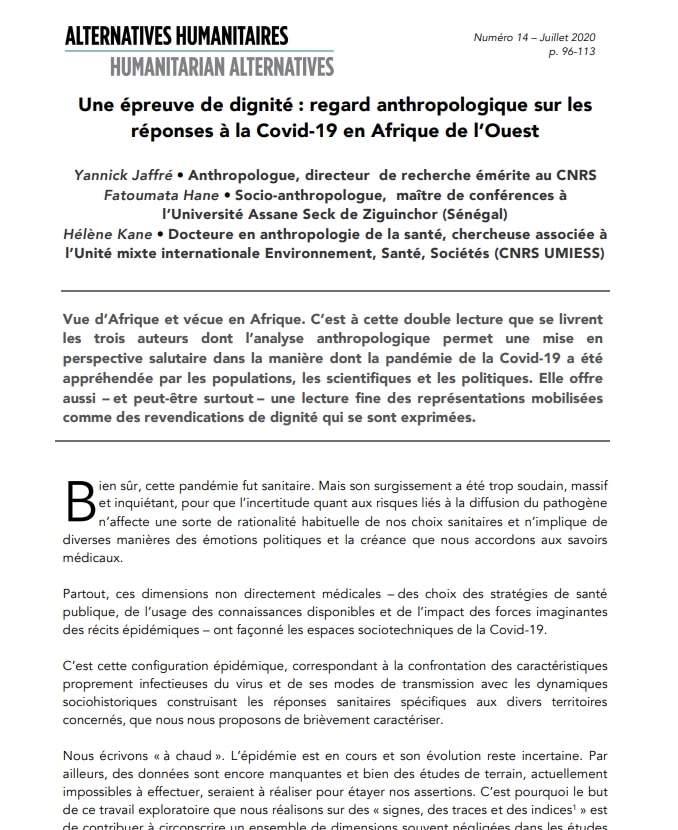Dans le monde, malgré de très importants programmes sanitaires1, 358 000 femmes décèdent pour des raisons liées à la grossesse ou l’accouchement, dont 204 000 en Afrique Subsaharienne (Ronsmans 2006, de Bernis 2010). Autrement dit, ou « plus humainement dit », en Afrique, une femme enceinte sur cent meurt de sa grossesse ou de ses suites.
Ces décès ‐ dont les causes médicales directes sont les dystocies, les hémorragies, les éclampsies et les infections – relèvent aussi, si l’on adopte une perspective plus englobante, de deux vastes dimensions sociales.
La première de ces causes concerne la fécondité. « Quand une femme européenne a en moyenne, 1.6 enfants, une femme africaine en a 5.2, multipliant évidemment d’autant le risque de mourir d’une grossesse » (Prual 2009 : 9). Pourtant, même s’il existe d’importantes différences entre les pays, « en 2008, ce sont seulement 9% des femmes africaines qui utilisent une méthode contraceptive moderne » (Prual ibid.). La seconde concerne l’efficacité de la prise en charge médicale des accouchements. Bien que les mesures efficaces pour réduire les décès maternels soient identifiées (césariennes de qualité, disponibilité de sang, usage du partographe …), la mortalité hospitalière ne régresse que très lentement (Prual 2004, Jaffré 2009).
Autrement dit, bien que dans ces deux domaines les problèmes soient connus et que des solutions techniques économiquement accessibles existent, les conduites reproductives des populations et les modalités de prises en charge obstétricales semblent « résister » aux propositions sanitaires supposées réduire les risques liés à la grossesse ou l’accouchement. Comment comprendre cela ? Pourquoi, malgré d’importants financements, les programmes peinent‐ils à atteindre leurs objectifs ? Comment expliquer la disjonction entre des propositions sanitaires qui devraient avoir l’assentiment de tous et des pratiques d’acteurs donnant l’impression de les ignorer, voire de les contrecarrer ?