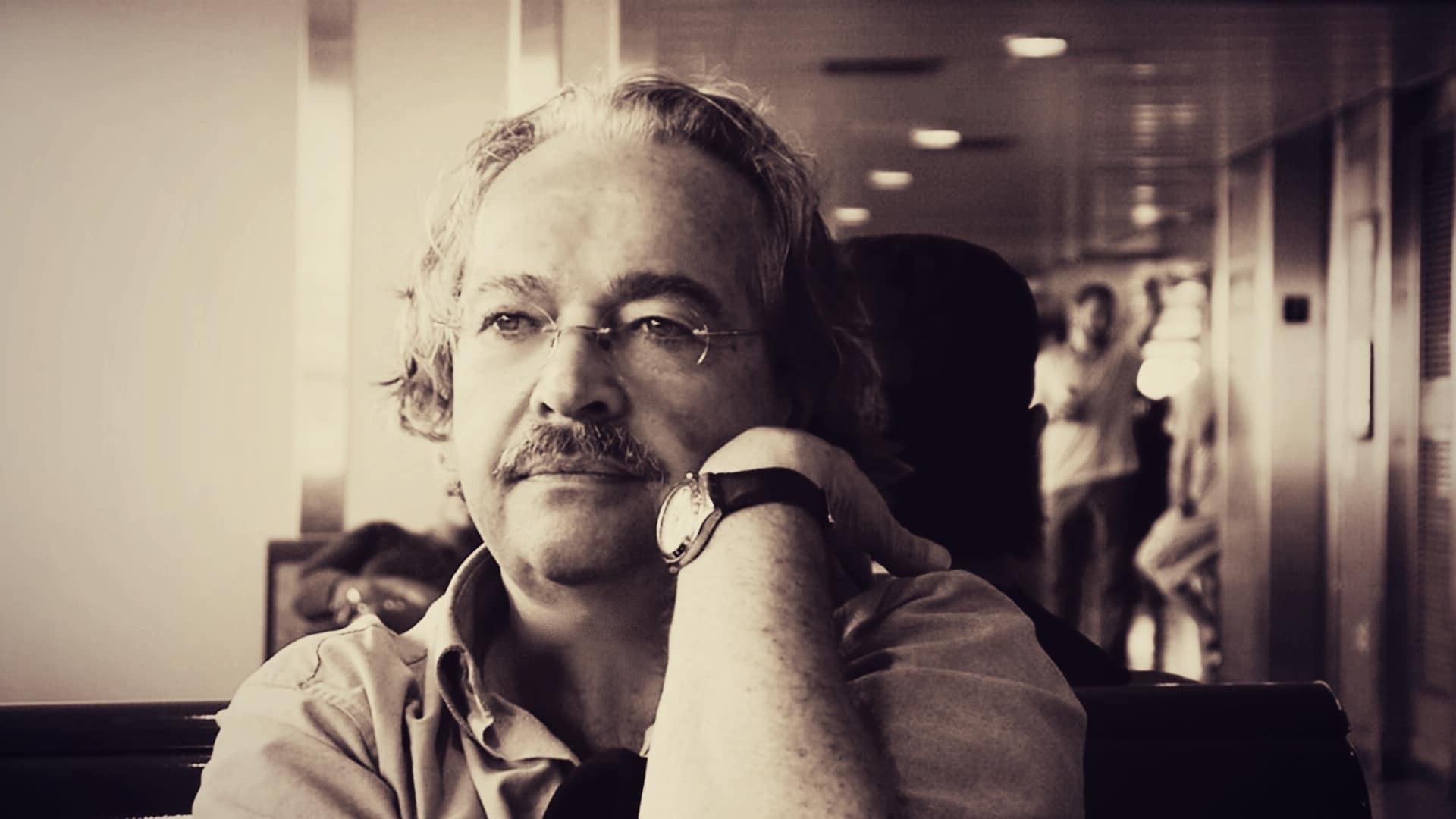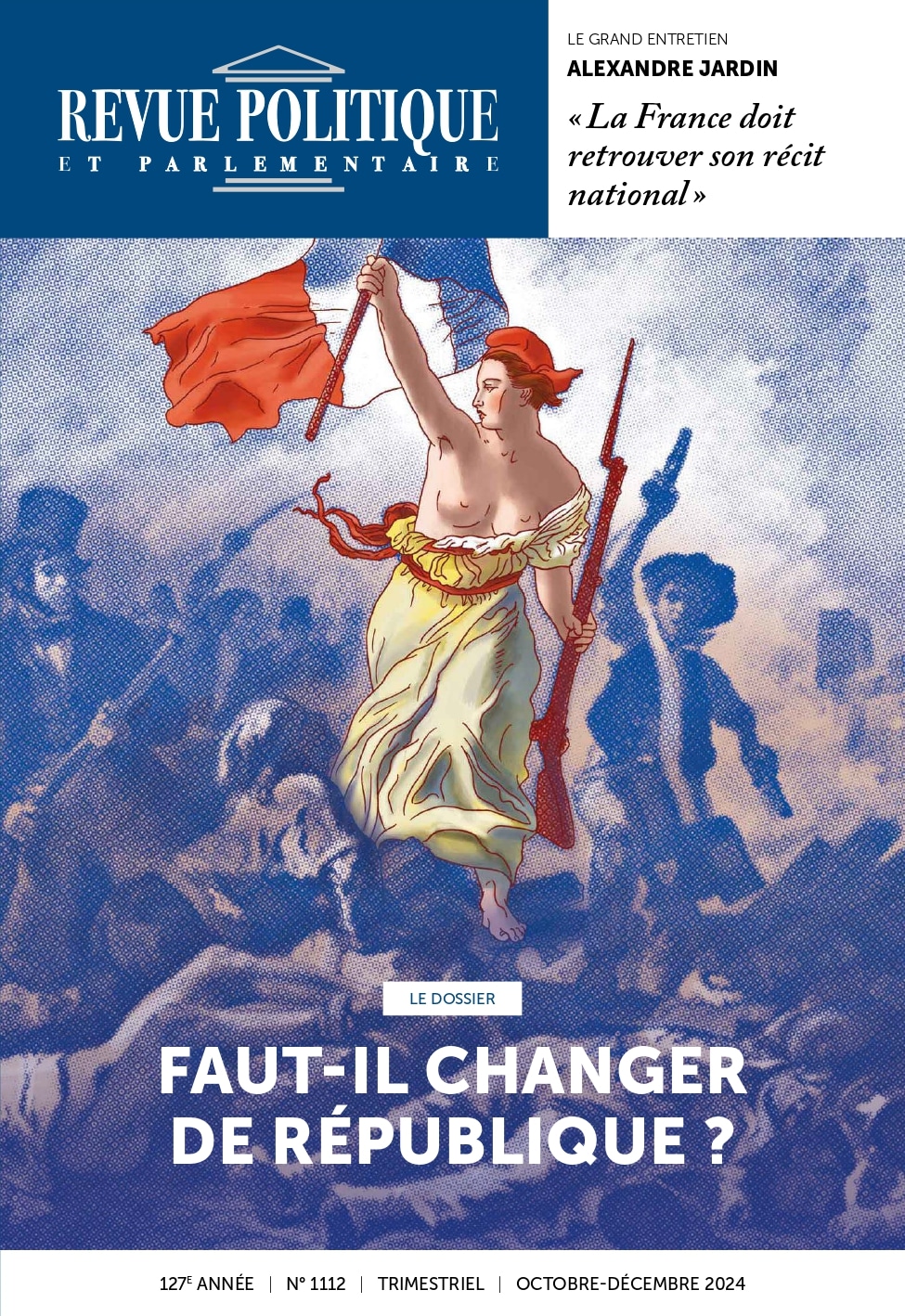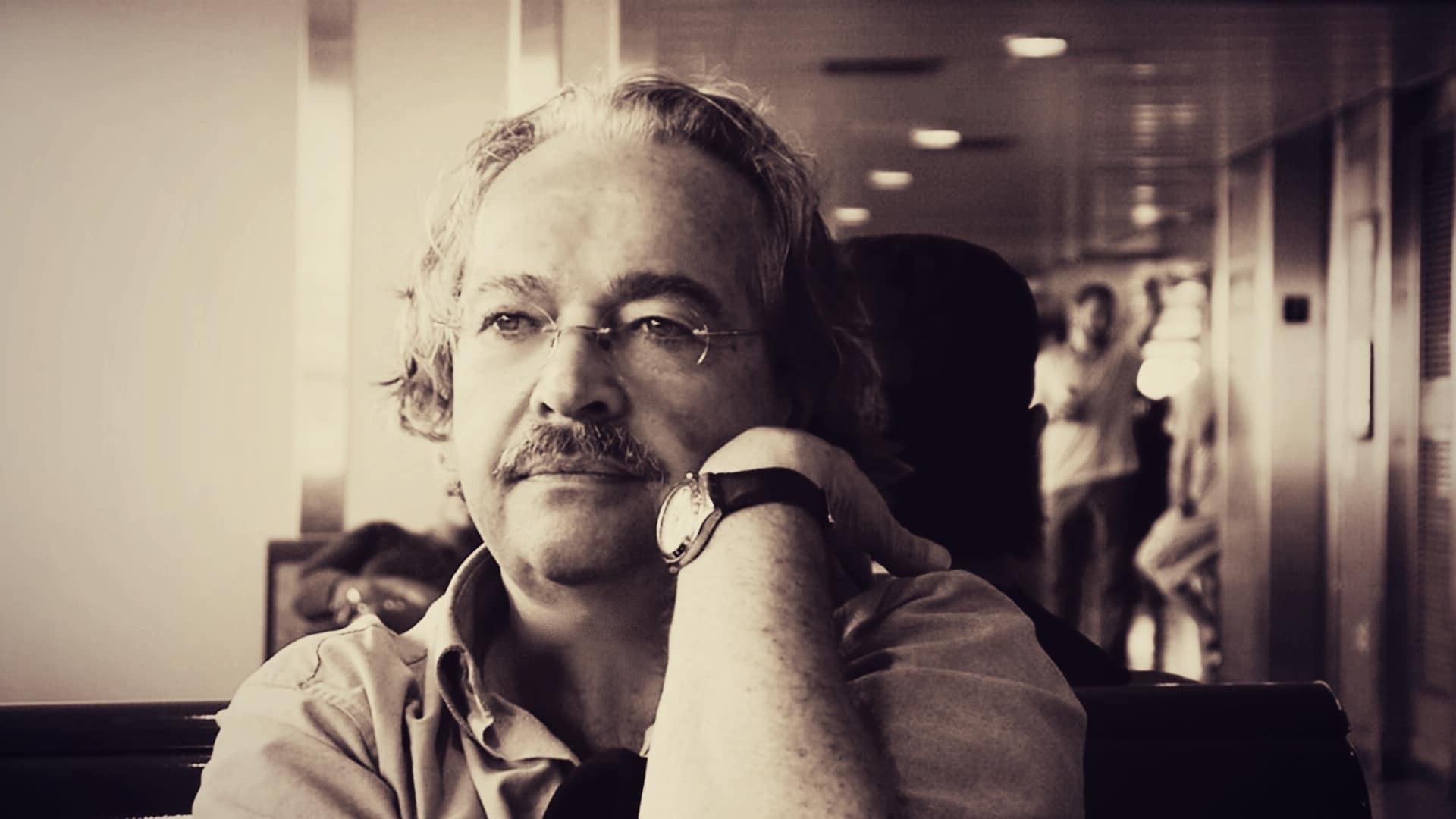
A l’évidence, la structure matérielle des villes, les politiques d’urbanisation, la pression démographique, l’énergie, le traitement de l’eau ou des déchets… constituent les « socles » des problèmes urbains et une large part de leurs « solutions » : leurs infrastructures.
Cependant, les agencements de ces diverses dimensions construisent aussi des « styles d’existence » des villes et dans les villes, influant sur les façons d’habiter les espaces urbains et modelant les types d’interaction entre divers segments de populations.
Qu’il suffise ici d’évoquer en guise d’illustration, la diversité des témoignages romancés de Mohamed Choukri découvrant conjointement la ville, sa violence et l’écriture (1980) ; Mouloud Feraoun faisant des hommes des sortes de paysages prolongés (1968) ; Manuel Vasquez Montalban décrivant Barcelone par ses saveurs, au gré des aventures du détective Pépé Carvalho ; Italo Calvino soulignant combien les villes sont des systèmes politiques et des formes de gouvernance liant le goût du pouvoir et l’amour des lieux (2002) ; Naguib Mahfouz mêlant l’histoire du Caire aux transformation des familles et soulignant combien découvrir la ville et oser la parcourir est une forme de libération (1987) …
Multiples sont les textes. Mais partout et quel que soit le contexte, l’objectivité des lieux (types d’habitat, densité de population, aménagements urbains…) se conjugue aux pratiques des acteurs pour constituer des « espaces » d’interactions sociales et affectives : « l’espace serait au lieu ce que devient le mot quand il est pratiqué » (de Certeau 1980, 208).
Comparées aux infrastructures matérielles, ces dimensions pratiquées – espaces perçus, manières de vivre, types de déambulation et de côtoiement des personnes … – et ces constructions de soi isomorphes des espaces vécus constituent globalement des sortes de causalités de second niveau.
Ces dimensions vécues [1] relèvent largement de divers mondes « sensibles » : sentiments, émotions, bruits, odeurs, mémoires des déambulations, orientations affectives des parcours, multiples variations des modestes proxémiques de la quotidienneté [2].
Ces catégories, bien que « fluides » et difficiles à quantifier, sont cependant heuristiques des conduites sociales et, de ce fait, à prendre en compte comme des faits sociologiques dans l’étude des espaces urbains et des pratiques des diverses populations vivant ou traversant les villes [3].
Pour le dire simplement, si l’étroitesse « objective » et mesurable d’un trottoir peut expliquer l’agacement des passants qui s’y bousculent, les motifs de l’action des acteurs proviendront, au gré d’une sorte de causation immédiate, des ressentis subjectifs et des agacements réguliers qui ne seront alors, pas sans conséquences sur d’éventuels comportements violents ou usages des infrastructures existantes … La Cité civilise ou défait l’humain, et les infrastructures et les subjectivités sont dans une construction réciproque.
Globalement, et sans volonté d’exhaustivité, interroger la ville depuis ces perspectives partielles et partiales des acteurs permet d’ouvrir divers champs de réflexion, que nous ne ferons ici que lister comme une sorte de « pense-bête » des dimensions à ne pas oublier pour penser une ville soutenable par tous dans leurs diversités :
- Analyser les diverses façons dont la ville est habitée par divers segments de populations se définissant par divers « sentiments d’appartenance »
- Etudier les formes discrètes d’appropriation par certaines populations ou genres – ou inversement d’exclusion – de certains espaces sociaux
- Caractériser les formes de sociabilités liées à des lieux spécifiques et ce faisant les cohabitations imposées qui s’y développent ainsi que les façons dont des ensembles normatifs dessinent des « frontières spatiales » vécues par toutes et tous sans véritable conscience de leurs existences
- Décrire et analyser les reconfigurations des lieux selon les caractéristiques des acteurs, les saisons, les heures, les évènements… soulignant ainsi la polysémie de tous les espaces sociaux
- Interroger sur la place des lieux liés à diverses conceptions religieuses ou idéologiques et régies de ce fait à d’autres régimes de temporalité (temps longs et circulaires des rituels, temps de la préservation du patrimoine, etc.)
Plus spécifiquement, en accord avec cette posture dessinée à grands traits nous distinguerons quatre vastes inquiétudes thématiques, tâches à entreprendre ou nécessaires investigations pour penser une ville « soutenable ».
1 – Analyser les sémantiques sociales
Il importe tout d’abord de s’interroger sur ce qui « tient une ville », lui assure une « identité vécue » et partagée, une pérennité changeante (Le Goff 1997).
Ce continuum ou chacun peut diversement se reconnaître est largement structuré par un ensemble de « lieux de mémoire(s) [4] » : des sites liés à des récits structurant l’histoire, les héritages et la continuité des villes.
A ce titre, une ville est toujours un ou une multiplicité de récits, un espace symbolique permettant un rassemblement du disparate autour de temps forts inscrits dans des lieux précis (commémorations, festivités, monuments…).
Cette remarque maintenant assez banale ouvre cependant à quelques questions.
- Le rituel, entraîne des formes d’adhésion à un espace sociopolitique et à une collectivité. L’adhésion – et le sentiment partagé de cette adhésion – est ici essentielle. Mais comment caractériser ces émotions politiques qui structurent nos façons de vivre les espaces urbains : le ressentiment de certains qui se marque dans les violences, la honte qui génère certains types de déambulation et/ou d’évitement, la crainte et la peur politiquement construites pour stigmatiser certains espaces sociaux et populations… Dresser une sorte de carte de ces « émotions politiques » est essentiel [5].
- Par ailleurs, l’inscription territoriale se marque aussi par les choix toponymiques. Qui est représenté dans les noms des rues, dans les statues ? Qui est nommé ou « gommé » de l’espace public et historique selon les multiples valorisations ou « oublis » que tissent les noms des rues ? Nommer c’est reconnaître des existences et des combats, éclairer des parts d’ombre et faire de certaines conduites des modèles éthiques. Nul ne s’y trompe, et les changements des noms des rues lors des changements politiques, les revendications de jeunes noirs aux USA concernant des généraux esclavagistes ou les protestations de certaines « communautés » en France, démontrent combien l’inscription urbaine est un enjeu de mémoire.
De relais en relais, mais aussi d’oublis en choix politiques, la ville est une sorte de palimpseste politique construisant des récits où certains segments de la population peuvent se reconnaître, ou au contraire, ressentir une volonté d’exclure. La ville construit ainsi diverses histoires sociales, et comment ne pas ici évoquer la présence des histoires notamment coloniales en chaque lieu des villes méditerranéennes. Construire un espace public et y accueillir la diversité des habitants consiste aussi à trouver les noms qui, même dans l’altérité, tressent contradictoirement, mais sans conflit, l’histoire et les « mémoires de deux rives » (Berque 1989).
2 – Comprendre et caractériser les diverses coprésences des populations
Le terme de « glocalisation » est devenu banal. Au plus simple il désigne les liens entre les déplacements de multiples populations – migrations économiques et sociopolitiques, retraités européens allant vers les pays du Sud ou de l’Asie, « tourisme » médical… – et leurs façons de recréer un « chez soi » dans ces ailleurs.
Autrement dit, une des caractéristiques des populations contemporaines est que les personnes sont « défixées » – « déterritorialisées » – agençant harmonieusement ou selon de multiples conflictualités des dimensions de l’origine et celles du présent.
Une nouvelle fois, cela n’est pas sans conséquences sur la structuration des « territoires vécus » et sur les diverses façons – contrastées et « inégalitaires » – dont des populations s’inscrivent harmonieusement ou conflictuellement dans des espaces historiques et politiques. Et ce faisant construisent aussi leurs relations et leurs interactions.
Une nouvelle fois sans souci d’exhaustivité, quelques vastes dimensions sociales de ces modernités peuvent être évoquées :
- Les territoires des appartenances et des obligations excèdent celui de l’immédiate existence ordinaire : obligations sociales et financières envers le pays d’origine ayant parfois l’aspect d’une « double absence » (Sayad 2014), acceptation d’une autorité régie par d’autres systèmes normatifs (Lagrange 2013), valorisation des modalités éducatives extra-européenne… (flux économiques vers les pays d’origine, obligations de mariage, rapatriement des corps lors des décès, envois de filles « au pays » pour leur éducation…). « « Cette population échappe aux logiques de fonctionnement des Etats-Nations et développe des capacités de métissages sociaux, culturels et économiques insolites, éloignées des formes classiques de l’intégration. A ce titre il développe l’idée « d’étranger de l’intérieur » et de « territoire circulatoire » pour signifier cette capacité qu’ont ces hommes à vivre dans plusieurs endroits et à organiser leur vie au sein […] d’une multiterritorialité » (Guillot 2007). Pour toutes ces raisons, penser le territoire consiste aussi à penser ses extensions, ses rhizomes et la façon dont les conduites localement observées correspondent à des négociations entre les normes et les choix de l’ici et les obligations et liens de l’origine.
- Les espaces de référence et les espaces émotionnels conjuguent le local et l’originaire (télévisions, match de football, élections…) et constituent des systèmes hétérogènes de références laissant évoquer des identités segmentées se conjuguant selon des « netscapes » déterritorialisés (Moïsi 2010 & 2016). Et ces événements, qui rassemblent ou distinguent des « publics » sur quelques traits d’appartenance, ont une large dimension politique. Cette circulation des modèles explique aussi pourquoi bien des riches demeures des pourtours méditerranéens ressemblent aux villas des feuilletons américains ou brésiliens, ou pourquoi certains équipements urbains donnent à des villes pourtant diverses les apparences de semblables « cités balnéaires » … La discontinuité géographique est recouverte par une continuité médiatique et partout des imaginaires « dominants » dialoguent avec des normes locales.
- Les langues parlées dans la ville et selon les types d’échange (affectifs, familiaux, économiques, scolaires…) constituent une palette complexe de normes et révèlent des « feuilletés identitaires » pluriels et inégalitaires (Calvet 1994). Qu’il suffise ici d’évoquer les façons dont certaines langues et accents – traces de l’origine dans l’énonciation – sont reconnues, valorisées, dépréciées. Au plus simple, retenons que penser la ville durable oblige à réfléchir aux effets complexes de ces chevauchements linguistiques et aux multiples procédures de traduction où le semblable ne se réduit jamais à l’identique (Ricœur 2004). La ville est un espace de traduction et de revendication, parfois conflictuels d’usages linguistiques, de discrètes revendications pour s’exprimer en certains lieux et circonstances dans une langue d’origine, voire une volonté hégémonique d’imposer une langue aux dépens des autres.
- De façon souvent « inconsciente » les villes se présentent comme une marqueterie d’espaces sensoriels – odeurs, bruits, manières de toucher – complexes. Ici encore, bien que discrètes ces unités spatiales de petites dimensions ayant une forte structuration affective déterminent diverses interactions entre des populations qui bien que physiquement proches peuvent appartenir à des cultures – sonores, gustatives, gestuelles… – différentes : refus des commerces aux odeurs « exotiques », protestations contre des « tapages », étonnement devant certaines manières de corps et modalités vestimentaires … Dans bien des cas « l’accessoire » comme présentation de soi est essentiel.
3 – Penser les usages inégalitaires des lieux et intégrer la pauvreté
Les pauvres sont les arpenteurs de nos villes modernes. Ils marchent d’un point d’hébergement à un autre, d’un restaurant à un autre, d’un dépôt de bagages à une halte sûre (Farge & alii 2004). De ce fait, les symptômes perçus par les SDF sont avant tout des symptômes fonctionnels entravant la marche (Farnarier & alii 2015). Ils peinent aussi à se maintenir propres, à conserver une certaine dignité. Et, au plus prosaïque, mais aussi au plus essentiel, faire ses besoins est une contrainte complexe – notamment pour les femmes – entrainant bien souvent de la honte.
A ce titre il a été envisagé de travailler à un « droit de se soulager » engageant non seulement des populations précaires, mais aussi des classes d’âges particulièrement concernées comme les jeunes enfants et les personnes âgées. L’aménagement de lieux d’aisance, de haltes, d’étapes où se reposer est essentiel à une ouverture de la ville pour tous.
Plus largement, « être à la rue » signifie manquer d’intimité, ne pas disposer de « coulisses » où préserver un « territoire du moi » (Goffman 1973), exister hors d’une certaine mise en scène de soi et où ne pas risquer ce que Goffman nomme des « offenses territoriales » (empiètement, intrusion, viol…) (66). Etre à la rue c’est être, dans tous les sens de ce terme, exposé aux regards, aux risques, aux demandes. C’est pourquoi les « sans domicile » sont épuisés.
Ces préoccupations d’offrir aux pauvres des haltes et des lieux d’aisance est souvent perçue comme contradictoire avec une certaine présentation touristique ou « gentrifiée » des villes s’attachant à gommer de leur image ces passants atypiques et surtout révélant une sorte d’envers des décors factices de la consommation.
Très concrètement, face à des demandes pour se maintenir, malgré la précarité, dans la dignité, les villes usent de mobiliers urbains empêchant bien souvent la halte (pics, bancs segmentés, mobiliers urbains empêchant de s’asseoir) et interdisent la construction de toilettes. Travailler concrètement ces questions est indispensable, notamment lorsque les représentations de la ville pour les touristes sont en opposition avec ces précarités existentielles. Plus encore, analyser la ville par ces conflits de co-présences de populations différentes sur de mêmes espaces est essentiel.
4 – Analyser les incorporations des espaces et leurs pratiques sociales
L’usage de variations d’échelles permet notamment de comprendre les différences d’usage des espaces selon les genres, les revenus ou les âges et d’analyser comment se construisent des inégalités d’accès à l’espace public.
Ainsi, pour ne prendre que quelques exemples simples – au plus « micro-focalisé » – dans les cours d’école le centre est souvent réservé aux garçons jouant au football alors que les marges sont occupées par les filles souvent occupées à des conduites ludiques plus calmes (Delalande 2001).
De même, les squares sont d’importants lieux de socialisation où, outre diverses techniques du corps (courir, danser, faire du vélo…) et de jeux anticipant des rôles sociaux (famille, soignant, armée…), s’apprennent des relations de classe d’âge (qui a droit de jouer et à quoi, d’user de certains espaces ou pas, de décider des jeux…) et d’apprentissage des distinctions sociales (qui joue avec qui, ou est exclu, qui use d’un autorité légitime, etc.).
Plus tard, de façon assez isomorphe de ces premières socialisations, les droits de déambulation seront notamment différents selon les genres.
Les jeunes filles – diversement selon les quartiers et les heures – incorporeront souvent des conduites de protection : positions corporelles de surveillance de l’espace proche, baisse du regard pour ne pas risquer de fausses interprétations de séduction, usages de fausses communications téléphoniques pour « donner le change » et éloigner les « dragueurs » …
Cette marqueterie autant objective que socio-subjective constitue de véritables territoires des présentations de soi légitimes. Et, par exemple, les vêtements – principalement féminins – sont choisis en fonction des risques ressentis et selon ce que les jeunes-filles anticipent des caractéristiques socio-normatives supposées régir les espaces de déambulation.
Mais, après cette très brève réflexion sur l’incorporation des normes liées aux caractéristiques sociales des espaces, allons au plus large. Globalement, le droit à déambuler librement et sans crainte – voire parfois sans sanction – est extrêmement variable et très inégal. Analyser la place et l’accès aux espaces publics notamment pour les femmes est essentiel (Assayag 2005 ; Le Renard 2011).
Partager équitablement les espaces sociaux, promouvoir le droit de déambuler, reconnaître les singularités
Ce parcours thématique est bien trop rapide et « en survol » pour prétendre à une quelconque dimension scientifique. Il s’agissait simplement de lister des domaines pour ne pas oublier de les traiter dans une réflexion sur les villes à venir.
Brièvement, nous avons traversé « différents “territoires” de la souffrance psychique d’origine sociale : souffrance de la précarisation et de la désaffiliation, de l’immigration et de l’exil, de l’enfermement ou du handicap, souffrance de l’identité et de la reconnaissance : souffrance au travail, souffrance à l’école, souffrance dans le genre… » (Delory-Monberger & al. 2010, 38).
Bien sûr, améliorer ces situations implique d’agir sur des socles concrets – matériels, financiers, politiques – structurant les possibles inscriptions de chacun dans la ville : disposer d’un revenu pour acquérir un logement, bénéficier de papiers pour circuler, de sécurité pour s’autoriser à « sortir » … Mais, sans attendre « des lendemains qui chantent » et que ces droits soient acquis, sans doute est-il possible et nécessaire de décrire et analyser les dimensions linguistiques, de genres, de génération… qui construisent les villes comme des lieux spécifiques et de tenir compte de cette polysémie complexe pour définir certaines actions.
Du fait de la démographie et d’une histoire faite d’enchevêtrements complexes ainsi que d’inégalités et d’imaginaires incitant à des déplacements des populations, les villes contemporaines – et notamment celles de la méditerranée – sont des villes de particulières co-présences et de co-existences de groupes humains, de normes, de sociabilités, de langues, d’affects…
Face à ces mouvements mondialisés, selon une perspective étayée sur des notions d’identités excluant et séparant de fait des autres « identités », chaque agencement spatial peut être pensé sur le mode de « codes territoires » disjoints, voire s’opposant à d’autres territoires. Un « chez moi » s’opposant à d’autres « chez moi » au gré de définitions infiniment régressives – du pays à la région, du village à la maison… – supposées correspondre à des déclinaisons et des valorisations illusoires des métonymies constituant toute identité.
A l’inverse, on peut – et sans doute n’a-t-on pas d’autre choix éthique – travailler sur des modalités de reconnaissance de la diversité des pratiques d’usage des lieux ainsi que sur les obligations et difficultés des acteurs. « Dans la notion d’identité, il y a seulement l’idée du même, tandis que la reconnaissance est un concept qui intègre directement l’altérité, qui permet une dialectique du même et de l’autre. La revendication d’identité a toujours quelque chose de violent à l’égard d’autrui. Au contraire, la recherche de la reconnaissance implique la réciprocité » (Ricœur 1995).
Une des procédures pour reconnaître ces altérités en contact consiste à « mettre un visage » sur les personnes rencontrées. Autrement dit, à lier un travail d’urbanisme à la construction d’une « démocratie » narrative permettant à chacun de se dire avec ses mots et ses contraintes. « Vivre en société, c’est en effet au premier chef, voir son existence appréhendée dans sa vérité quotidienne. Des vies non racontées sont de fait des vies diminuées, niées, implicitement méprisées. […] Etre représenté, à l’inverse, c’est être rendu présent aux autres, au sens propre du terme. C’est être pris en compte, être reconnu dans la vérité et la spécificité de sa condition » (Rosanvallon 2014, 10 & 11 ). Tenir compte des sociographies plurielles et contrastées des acteurs ouvre à une pratique dialogique pacifiant une ville moderne toujours plurielle et potentiellement conflictuelle.
Si l’on s’accorde sur cette large proposition, il en découle quelques propositions simples.
Cela signifie, en amont, éduquer les enfants à cette approche contrastive de la ville, à dresser des cartographies comparées des usages des espaces : perception selon les genres et les âges, sphères auditives, mondes olfactifs, jeux, etc. Globalement à construire pour les citoyens – et dès le plus jeune âge – des approches réflexives de leurs pratiques urbaines.
Il importe aussi de construire des « biographies » urbaines, montrant comment chacune – et surtout chacune – vit et peut se déplacer dans la ville. Quels sont les droits concrets à occuper les espaces publics : trottoirs, terrasse des cafés, moyens de déplacements… Quelles émotions sont associées à ces lieux spécifiques : peur, plaisir, sentiments de honte, illégitimité…
Ces travaux, démontrant des postures contrastées voire conflictuelles, pourraient faire l’objet d’expositions, de discussions entre les différents usagers de la ville, et tenter ainsi de tisser par la parole, des points de ruptures comportementales (violence des relations de genres, exclusion des personnes non-productive, situation des handicapés…).
Une ville durable/soutenable est une ville qui trouve les mots pour se dire dans la pluralité de ses expressions.
Bibliographie
Agulhon M., 1988, L’histoire vagabonde (1 & 2), Paris, Gallimard
Ansart P., (sous la dir.) 2002, Le ressentiment, Bruxelles, Bruylant
Assayag J., 2005, La mondialisation vue d’ailleurs, Paris, Seuil
Berque J, 1989, Mémoires de deux rives », Paris, Seuil
Calvet L.-J., 1994, Les voix de la ville, Paris, Payot
Calvino I., 2002, Les villes invisibles, Paris, Gallimard
Certeau (de) M, 1980, L’invention du quotidien (1 & 2), Paris, Gallimard
Choukri M., 1980, Le pain nu, Paris Maspéro
Corbin A., 2000, Historien du sensible, Paris, La Découverte
Corbin A., 2001, L’homme dans le paysage, Paris, Textuel
Delalande J., 2001, Cour de récréation, Contribution à une anthropologie de l’enfance, Rennes, Presses Univ de Rennes
Delory-Monberger C., Niewiadomski C., 2010 ; Ecouter la souffrance entendre la violence dans Le sujet dans la Cité N°1, Univ Paris 13, Téraèdre, 37-38
Farge A., Laé J.-F., Cingolani P., Magloire F., 2004, Sans visages. L’impossible regard sur les pauvres, Paris, Bayard
Farnarier C., Fano M., Magnani C., Jaffré Y., 2015, Trajectoire de soins des personnes sans abri à Marseille, EHESS Lassa
Feraoun M., 1968, Jours de Kabylie, Paris, Seuil
Frémont A., 1999, La région espace vécu, Paris, Gallimard
Goffman E., 1973, La mise en scène de la vie quotidienne, Paris, Ed de Minuit
GuillotG. 2009, « Autorité, respect et tolérance », Les Sciences de l’éducation – Pour l’Ère nouvelle, vol. vol. 42, no. 3, 33-53.
Lagrange H., 2013, En terre étrangère. Vies d’immigrés du Sahel en Ile de France, Paris, Seuil
Le Goff, 1997, Pour l’amour des villes, Paris, Textuel
Le Renard A., Femmes et espaces publics en Arabie Saoudite, Paris, Dalloz
Mahfouz N., 1987, Le palais du désir, Paris, J.-C. Lattès
Moïsi D., 2010, La géopolitique de l’émotion, Paris, Gallimard
Moïsi D., 2016, La géopolitique des séries, Paris, Stock
Nora P., (sous la dir.) 1984, Les lieux de Mémoire, Paris, Gallimard
Paquot T., Lussault M., Younés C., 2007, Habiter, le proper de l’humain, Paris, La Découverte
Pétonnet C., 2018, Variations sur la ville » Paris, Biblis – CNRS Editions
Pitt-Rivers J., 1977, Anthropologie de l’honneur, Paris, Hachette
Ricœur P., 1995, La critique et la conviction, Paris Calman Levy
Ricœur P., 2004, Sur la traduction, Paris, Bayard
Robin C., 2004, La peur. Histoire d’une idée politique, Paris, Armand Colin
Rosanvallon P., 2014, Le parlement des invisibles, Paris, Seuil
Sayad A., 2014, La double absence, Paris, Seuil
[1]Sur cette question, voir le beau livre inaugural d’Armand Frémont : « la région espace vécu » (1999). Nous renvoyons aussi globalement au livre collectif : « habiter, le propre de l’humain. Villes, territoires etphilosophie » ( 2007).
[2]Sans entrer dans le détail des diverses thématiques évoquées correspondant à des publications thématiques spécifiques, sur ces questions nous renvoyons globalement aux travaux de Alain Corbin et pour un « accès simplifié » à deux présentations synthétiques (2000 & 2001).
[3]Nous renvoyons ici aux travaux de Colette Pétonnet et notamment à ses « variations sur la ville » (2018) où elle démontre, par touches successives, l’importance des dimensions sociales et socioaffectives dans la compréhension des pratiques urbaines.
[4]C’est bien sûr faire ici référence au livre de Pierre Nora (XX) ainsi qu’aux travaux de Maurice Aghulon (1988).
[5]Nous ne pouvons ici développer ces dimensions historiques et anthropologiques caractérisant des émotions politiques (Ansart 2002, Pitt Rivers 1977, Robin 2004…)
Galerie photos
Notes_anthropologiques_sur_quelques_dimensions_vecues_des_espaces_urbains.pdf