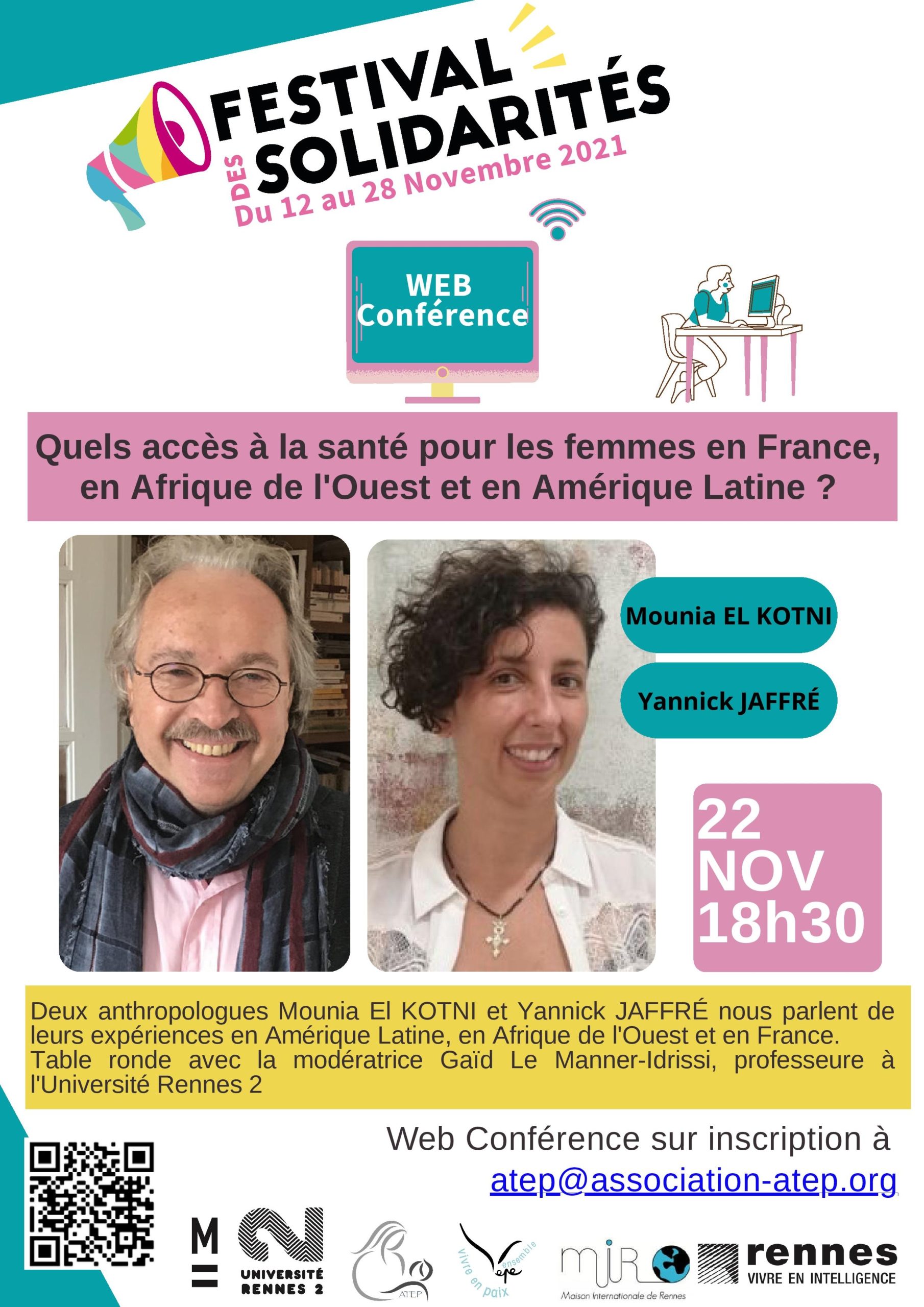Méthodes : au sein d’une maternité d’un hôpital de district de la périphérie de Dakar, de 2003 à 2006, les anthropologues (dont une sage-femme) ont effectué une analyse des facteurs compliquant la prise en charge des parturientes. A ensuite été mise sur pied une intervention, impliquant les professionnels de santé, et visant à les amener à s’approprier de nouvelles pratiques : des « rencontres-miroirs » ont été créées et se sont tenues régulièrement, dans un cadre préservant la confidentialité ; des cas y ont été décryptés et discutés de façon à identifier consensuellement les points de blocage et les difficultés dans la prise en charge obstétricale. Ces études de cas étaient alimentées par les observations des chercheurs et des professionnels eux-mêmes.
Résultats : Les professionnels de santé ont progressivement accepté de discuter collectivement de leurs pratiques – sur des cas précis – en donnant leur avis et en acceptant ceux des autres. Cela s’est traduit par une amélioration de la communication au sein de l’équipe, essentielle lors de la prise en charge de l’accouchement. Se sont aussi révélées des tensions au sein de l’équipe et avec la hiérarchie sur lesquelles les professionnels se sont penchés. Si le principe de « regard sur sa pratique » a transformé les gestes de soins et le fonctionnement de l’équipe, la tenue en elle-même des « rencontres-miroirs » n’a pu être pérennisée pour des questions d’appropriation de l’activité par la hiérarchie médicale après l’arrêt du projet
Conclusion : l’anthropologie peut contribuer à l’amélioration des pratiques dès lors qu’elle crée un cadre de dialogue, apaisé, où la réflexion technique sur les gestes médicaux est associée à un travail sur la communication au sein de l’équipe soignante.